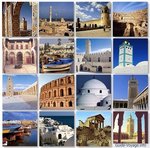Hubert Joly
- Sfax instantané
- De Tunis à Tozeur
- Tozeur
- Les iles Kerkena
- Automne à Korba
- Kélibia
- L'été à Tunis
- Djerba
- Sidi Bou Saïd
- Ramadan
- Mourir pour Testour
- Petites choses vues…ou rêvées
- Révolution à Kelibia
- On ne fait pas de brik…
- Vers une NEO-NAHDA ?
- Par le trou de la serrure
Sfax Instantané
On devrait couper la tête de ceux qui se permettent de porter un jugement sur une ville après une demi-heure de visite. C'est pourtant ce que je suis en train de faire à peine sorti de la gare. Mais j'aime les impressions toutes chaudes, alors tant pis pour moi si le bourreau me saisit.
J'ai plutôt apprécié l'urbanisme du centre ville : un urbanisme à la française, clair et dégagé, qui annonce, conduit et met en scène les bâtiments. Une sorte de Canebière au sortir de la gare, bordée de palmiers, dans l'axe de la station du chemin de fer, une esplanade piétonne qui fait transition entre la grande porte de la médina et l'hôtel de ville et qu'elle met en valeur.
C'est très différent du style de la capitale : peu de façades italianisantes comme celle du 43 de l'avenue Bourguiba mais de beaux bâtiments d'architecture coloniale, comme l'hôtel de ville encadré de deux édifices du même style : un bijou de façade où la pierre ocre rose dialogue magistralement avec l'enduit clair, la Maison de France,, ou ce grand immeuble aux fenêtres géminées qui ont perdu leurs colonnettes et que les Sfaxiens ont eu bien raison de faire classer pour éviter sa destruction. Dans l'ensemble, on se croirait presque au Maroc, chez Lyautey.
Bien sur, rien n'est parfait. Le dynamisme économique fait pousser les grands immeubles qui ont tendance à écraser les plus anciens mais l'on compte quelques réussites comme l'assemblage réalisé à l'Hôtel des Oliviers.
Contraste évident avec la médina. A la tombée de la nuit, derrière l'écorce rugueuse des murailles, seule était encore animée d'un peu de sève et de lumière la rue qui leur est parallèle avec ses entrées d'hôtels, ses restaurants de poulet, ses échoppes de barbier. Plus à l'intérieur, c'était la nuit. Les derbs qui s'enfoncent comme des coins enfoncés dans du bois dur ne semblaient même pas des chemins, tout au plus des cheminements mystérieux conçus pour le seul usage des particuliers. Tout se passe comme si la ville voulait se dérober aux yeux de l'étranger...Mais avec le jour, tout se transmute et revit. La trame orthogonale de la médina, peu fréquente dans les villes arabes, se dessine clairement et l'on est tout surpris de voir que ce qui était si vide est soudain devenu si plein....
En ces temps d'affolement financier, je m'amusais de voir que la première page des journaux tunisiens de langue française ignorait superbement la crise comme s'il s'agissait d'une autre planète. Certes, ce n'est pas la crise qui rendra moins brillant le sel des chotts, qui déplacera l'alignement des oliviers à perte de vue ou qui arrachera des pierres au Colisée.
J'en fis la remarque à un mouton noir et blanc qui passait par là.
« Monsieur le chibani, me répondit-il, il n'y a peut-être pas que des mauvaises choses dans cette crise. Ainsi, moi qui étais destiné à être vendu et mangé par des banquiers aux doigts tachés par l'argent sale, je vivrai peut-être un peu plus vieux s'il n'y a plus de flouss ou,, tout au moins, je serai mangé en famille par des gens qui m'ont cajolé lorsque j'étais enfant... Le petit Kader et la petite Leila qui sont un peu fluets en profiteront et je ferai un méchoui très satisfait... Même dans les moments les plus difficiles, voyez-vous, il faut toujours se créer des raisons d'espérer ! »
Hubert JOLY, 5/11/2008
De Tunis à Tozeur
En ce temps-là, c'est-à-dire en l'an de grâce 2008, mois de février, à l'époque où les amandiers commencent à fleurir du côté de Sousse, le train mettait neuf heures de Tunis à Tozeur.
J'étais curieux de voir cette palmeraie si vantée dont je possédais un minuscule tableau représentant un marabout parmi les palmes. J'avais décidé d'être particulièrement attentif et curieux car j'avais été un peu vexé de rester en panne sèche d'impressions lors de mon passage à Jerba deux mois plus tôt.
Jusqu'à Sousse, rien à dire si ce n'est que mon sandwich est un peu fort en harissa... Puis, à ma droite le Colisée d'El Jem qu'on voit très bien du train et que j'avais visité un quart de siècle plus tôt, quelle horreur !. Au bout de près de quatre heures, arrivée à Sfax. Les bateaux sont à quai, les bacs qui conduisent aux iles Kerkennah aussi ; rien ne semble avoir changé depuis deux ans que je suis passé.
A partir de la sortie de Sfax, je découvre avec stupéfaction que la voie ferrée est devenue l'épicentre d'une décharge sauvage de plus de cent kilomètres de long, où s'amoncellent débris de carrelage et de maçonnerie et plastiques du plus mauvais effet. On a beau essayer de regarder vers le lointain pour préserver la vision patriarcale sur les rangs d'oliviers à l'infini, le regard est sans cesse ramené aux tas d'immondices.
Après El Rariba puis El Founi, les arbres laissent de plus en plus la place à une steppe tondue en coussinets par les ovins et qui, en cette saison, parait bien maigre. Contre ma volonté, l'Administrateur de la France d'Outre-mer qui n'est pas mort en moi se réveille, et j'imagine ce que serait le paysage si l'on voulait me confier ces étendues que je m'empresserais de mettre en défens.
Parmi les terres profondément griffées par une érosion anarchique, je barrerais les ravineaux et j'y installerais des robiniers, j'engrillagerais des parcelles d'un hectare pour permettre la régénération naturelle des graminées et servir de réservoir de graines, j'organiserais le pacage contrôlé des troupeaux, ensemencerais d'alfa. Peut-être une version écologique de Perette et le pot au lait mais je sais faire reverdir et revivre ces contrées...
Pourtant, mon rêve s'interrompt.
Sur une profondeur de deux-cents mètres environ, s'égaient des milliers et des milliers de sacs plastiques qui, par endroits, constituent le seul ornement de ces étendues désolées. Même si la moitié d'entre eux est colorée du joli bleu tunisien, avec des reflets brillants au soleil, cette vue est proprement, c'est-à-dire salement, insupportable. Je sais bien que les habitants, question de formation et de culture, ne les voient même pas, comme ils sont indifférents à tout ce qu'en France on appellerait maintenance des espaces collectifs. Je ne sais ce qui me retient de faire arrêter le train pour les ramasser. D'autant qu'il doit y en avoir pour une belle somme à recycler avec ce tonnage éparpillé.
Depuis El Founi, deux arêtes montagneuses, à gauche et à droite, encadrent, presque rectilignes, la voie ferrée. A nouveau les champs d'oliviers s'étendent jusqu'aux piedmonts. La proportion d'amandiers en fleur ou d'abricotiers augmente. De plus en plus de figuiers de Barbarie végétalisent les talus. Tout cela ne manque pas de grandeur à la lumière du soir mais cette géométrie ouverte de rangs d'oliviers laisse peu de place à l'imagination : on sait que tout au bout du regard, il n'y a pas de mystère, pas d'inconnu, seulement de nouveaux alignements d'oliviers...
Les alternances de steppe et de plantations se poursuivent sans qu'on en découvre la cause. Peu à peu, à gauche de la voie, un oued s'enfonce dans des terres meubles qu'il découpe profondément. La ligne de chemin de fer s'incline vers la gauche à quelque distance des méandres qui se tordent. Quelques palmiers apparaissent. Serait-ce une oasis ? Mais oui c'en est bien une, ou plutôt, comme aurait dit Fernand Raynaud, ça a eu été une oasis. Maintenant cela s'appelle Gafsa, avec des palmiers grisâtres au milieu des wagons de phosphate. L'arrivée est bétonneuse, briqueuse, poussiéreuse. Circulez, y a rien à voir ! Et effectivement, il n'y a plus rien à voir car la nuit est tombée. Je ne saurai jamais comment pouvait être Metlaoui : un grand trou de phosphate ou simplement un trou ? J'en ai peu de regrets.
Me voici enfin à Tozeur. L'oasis ? la palmeraie ? Ce sera pour demain, inch'Allah...
TOZEUR
Quand je songe que j'ai publié avec le GRET des Eléments d'agronomie saharienne il y a près de trente ans, et que je parcours seulement aujourd'hui pour la première fois une véritable oasis, mes cheveux se dressent sur la tête. Comme le chante Carmen, j'étais vraiment trop bête...
Devant moi, sur la terrasse de l'hôtel, les têtes des palmiers qui s'inscrivent dans des cercles, comme ceux de Majorelle, forment une muraille verte continue, plus dense que celle de la vallée du Draa rapidement entrevue. Tous mes fantasmes d'administrateur peuvent se donner libre cours.
Mais si je veux inscrire une chronique méditerranéenne supplémentaire dans ma liste, alors je dois photographier aussi exactement que possible ce que j'ai vu et qui sera, si je suis objectif, historiquement daté dans un monde qui change si vite. Alors, j'ai passé toute la matinée et tout l'après-midi à marcher dans la palmeraie. Je n'ai fait grâce à aucun propriétaire, aucun fellah, aucun khammès, aucun caléchier de mes questions. Je les ai pressés comme de vulgaires citrons et j'en ai recueilli tout le jus que je pouvais.
Je vais essayer maintenant de livrer mes impressions aussi justement que possible.
L'abord est un peu décourageant car la piste qui longe la première seguia en bordure de la palmeraie sert, là aussi, de décharge sauvage pour plastiques et matériaux de construction. Si l'on s'enfonce un peu, on longe des clôtures qui mêlent barbelés et palmes sèches à demi-effondrées. Mais nous ne sommes qu'à la mi-février et les travaux de printemps commencent tout juste. Déjà, nombre de parcelles sont irriguées à l'avance. Quelques-unes sont défoncées avec une grosse houe à manche court, la mes'ha. Déjà, dans certaines, des fèves commencent à fleurir. Je dis « des » et non « les » car leur densité ne me parait pas très grande et souvent elles ne sont plantées qu'en bordure des petits rectangles. Bien entendu, ici toute l'irrigation se fait par submersion. Il parait que les sources artésiennes sont taries et que l'eau disponible aujourd'hui dans la nappe provient de forages et de pompes. « Et demain qu'en sera-t-il ? » ai-je demandé. On m'a répondu en levant les yeux au ciel. J'en conclus qu'il vaut peut-être mieux ne pas trop tarder à admirer car, il y a vingt ans, j'avais déjà vu le même phénomène dans l'oasis d'El Hama et je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue.
J'avance toujours et m'enhardis à pénétrer dans les jardins qui sont tous ouverts quand je vois des ouvriers travailler ou faire de petits feux. Les petites levées de terre qui limitent les parcelles sont autant de petits sentiers aléatoires, entre les palmiers qui font la structure de l'ensemble. Dessous, règne une aimable anarchie avec, de loin en loin, de grands pêchers et de grands abricotiers qu'on a laissé monter et qui, juste en fleurs maintenant, apportent leur inégalable touche de poésie rose et blanche. A côté, les grenadiers sont encore secs, les figuiers osent à peine de petits bourgeons. Parfois un géranium, les fruits rouges de rosiers aux croisements des allées, quelques abutilons, des jasmins et même des chèvrefeuilles ployés à 45° pour rejoindre les troncs des palmiers sur lesquels ils s'appuient. En beaucoup d'endroits, des oxalis à fleurs jaunes habillent le sol et l'on croise des carrioles qui les transportent aux étables. La plus jolie saison est le mois de mars, m'ont dit les jardiniers, lorsque la verdure a vraiment démarré. Ce désordre n'est pas déplaisant et l'on devine ce que doit être ce vert paradis lorsque les parcelles sont nettoyées, que les premiers légumes sortent de terre et que tous les étages de la végétation ont fait leur feuillaison.
J'ai demandé combien couterait un hectare pour faire un jardin botanique, ma marotte de toujours. Il faut calculer la valeur de la récolte et multiplier par dix pour avoir le prix du terrain. C'est donc la qualité des palmiers, pas tous des Deglet nour, qui fait le prix, de 25 à 80 millions de millimes l'hectare, mais plus si la production atteint dix millions.
Il faut encore s'enfoncer plus loin pour ne plus entendre aucun des bruits de la ville, écouter, observer les oiseaux. j'ai dérangé un héron qui pêchait dans la séguia. Il y a plein de tourterelles et de pigeons. des troupes de passereaux effarouchés s'enfuient, les ailes translucides dans le soleil. Deux huppes insolentes vont et viennent, picorantes, sans même m'accorder un regard puis, d'un coup, s'envolent dans un grand froufrou beige, noir et blanc. Je suis sous le charme.
Quand la qualité du travail de l'homme s'ajoute à l'exubérance de la nature, la rigueur de l'une met en valeur le foisonnement de l'autre. Il me semble que c'est cela l'apport original du jardin arabe à la civilisation, loin des jardins italien, français ou anglais. Un rien de nonchalance, de laisser-aller, plait à la fantaisie des plantes. C'est dans cette liberté que leur laisse l'homme qu'elles apportent leur grâce et leur harmonie. Si les parfums s'y ajoutent, on approche d'une certaine perfection... Le paradis, c'est une oasis. Enfin, je crois. Hubert JOLY, 2008
LES ILES KERKENNAH, UN ESSAI DE DIAGNOSTIC
Peut-être le regard d'un étranger est-il utile lorsqu'à l'occasion d'une visite rapide, il a la possibilité de faire une synthèse de ce qu'il a vu ou cru voir en trente-six heures à peine et qu'il en retire une « impression » aussi bien visuelle qu'intellectuelle.
Les Kerkenniens, qui vivent au jour le jour dans cet environnement, ne voient peut-être plus certaines choses, et c'est normal du fait de l'accoutumance, ou bien, trop impliqués dans les tâches quotidiennes, trop engagés sentimentalement dans la défense et l'illustration de leurs iles, éprouvent quelque difficulté à voir les choses de l'extérieur, sinon objectivement.
Nul ne conteste aujourd'hui que les iles de la Méditerranée sont en crise et que leur problématique est à peu près partout la même...
Essayons de porter un regard neuf sur les îles Kerkennah.
L'isolement des iles par rapport au continent est un fait trop connu pour qu'on s'appesantisse dessus mais il aura suffi d'une tempête survenue à point nommé pour que tous les inconvénients de l'insularité apparaissent au grand jour.
Pour le visiteur qui débarque aux iles Kerkennah, les premières impressions, dans l'ordre, sont les suivantes :
1) Le littoral, au moins en cette saison d'avril, offre le spectacle désolant de l'accumulation des débris de plastique de toutes sortes. C'est évidemment une contrepublicité touristique totale et il est opportun pour les responsables des îles de faire organiser avec une intensité suffisante le ramassage des déchets qui ne sont pas imputables aux iliens mais sans doute aux grandes villes du littoral...Même hors saison touristique, le ramassage doit être fait sinon l'image est déplorable.
2) La palmeraie agonise. Sa densité a fortement diminué, l'entretien des pieds n'est plus pratiqué. Même si les dattes des iles sont de qualité moyenne, la palmeraie est un archétype de paysage qu'il ne faut pas laisser mourir et qu'il faudrait beaucoup de temps pour remplacer par autre chose. La tentative menée par des Italiens de réhabiliter une parcelle de la palmeraie semble menacée dans la mesure où cette parcelle est à la veille d'être attaquée par la mer. Si le dépérissement de la palmeraie est dû aux infiltrations de sel dans des terres insuffisamment hautes, il faut complètement repenser la gestion de ces espaces qui seront bientôt désolés.
3) Les îles sont attaquées par la mer sur tout le pourtour du rivage et la tempête qui a sévi dans la nuit du 9 au 10 avril 2005 a vraisemblablement mangé une trentaine d'hectares. Des palmiers ont été déracinés par la mer, des pistes attaquées. Le phénomène n'est pas nouveau mais il prend une ampleur inquiétante et il a beaucoup progressé en cinquante ans. À l'époque romaine, on pouvait gagner les iles à pied depuis le continent. Il y a belle lurette que cela ne peut plus se faire mais il s'agit maintenant de la survie des iles.
4) Depuis une vingtaine d'années, des constructions sans caractère envahissent de nombreux secteurs de l'ile sans aucun plan ni logique. Cette anarchie contribue terriblement à un enlaidissement du paysage sans qu'on aperçoive aujourd'hui la moindre tentative de porter remède à cette dégradation. Il est certain que l'amplitude du phénomène touristique (de 10 000 habitants en hiver à 180 000 en été) met en péril tout l'équilibre économique, écologique et social.
5) Apparemment l'économie des iles n'est plus fondée aujourd'hui que sur deux ressources : la pêche, et un tourisme que personne ne contrôle et qui par conséquent n'apporte sans doute pas beaucoup de ressources aux iliens.
Alors, quel avenir ???
L'avenir agricole sur terre.
Existe-t-il encore des agriculteurs qui veulent continuer à exploiter la palmeraie ? Traditionnellement tous ses matériaux étaient utilisés dans l'économie de subsistance quotidienne. Quel serait le prix d'une réhabilitation, notamment en remplaçant les arbres atteints de fusariose par des variétés indemnes du bayoud ? Il faudrait interroger les Italiens sur le bilan de leur expérience...
A terre toujours, les iles Kerkennah regorgent de restes d'époque romaine. La plupart n'ont pas été fouillés. Ceux qui ont fait l'objet de fouilles sont mal protégés et vont disparaître en peu d'années. D'autres sont mangés par la mer.
Une partie du patrimoine des iles et de la Méditerranée disparaît donc à jamais. Il est absolument impératif de protéger en périphérie et en surface ce qui a été fouillé et d'interdire l'accès aux zones non fouillées avant qu'un programme concerté permette de connaître ce qui est encore enfoui...Mais plutôt ne rien faire que de fouiller et de laisser à l'abandon ce qui a été découvert.
C'est une ressource touristique essentielle si elle est protégée et mise en valeur mais, aujourd'hui, elle ne présente qu'un intérêt marginal pour les touristes.
Dans les mêmes conditions, il faut constituer un espace agricole protégé et un espace écologique mis en défens par engrillagement et interdiction de toute activité, afin de conserver un patrimoine végétal et biologique menacé.
En mer l'urgence est de protéger les côtes.
Mais si l'on veut éviter le développement d'une urbanisation anarchique, laide et destructrice du paysage, on peut essayer de faire d'une pierre deux coups : concevoir un mécanisme de protection d'un certain nombre de baies (deux ou trois) en les transformant en marinas pour constituer à la fois des points de fixation d'une urbanisation qui, de toute façon, se développera et éviter ainsi le mitage de la palmeraie et du reste de la campagne.
Mais bien entendu, pas n'importe quelle sorte de marina mais une marina qui respecte le caractère de la maison traditionnelle kerkennienne sans étages, ni fioritures de balcons, balustres et autres excroissances, sans faïences extérieures ni couleurs agressives...et sans port, mais avec des canaux sur lesquels circuleraient les seules embarcations traditionnelles des iles et des quais modestes : une sorte de Venise rurale et tunisienne et non une copie de Port El Kantaoui, même si la marina de Port El Kantaoui est plutôt une réussite. On peut peut-être s'inspirer un peu du livre de Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes. Aux îles Kerkennah, c'est de la modestie des bâtiments et de l'urbanisation, de la qualité de l'ordonnancement que viendra la beauté, non du grandiose. On peut aussi concevoir un ensemble conçu selon le modèle pompéien, mais évidemment pas dans le ramassis de styles pseudo n'importe quoi de la nouvelle médina de Port El Kantaoui qui plait peut-être aux touristes mais constitue une agression à l'esthétique, alors que chacune des architectures mélangées, si elle avait été retenue et développée seule, aurait pu aboutir à un résultat plus heureux... pour tant l'argent investi dans le mauvais gout.
Ces petites Venise devraient se trouver du côté ouest des iles pour bénéficier de la protection des iles contre le vent.
De l'autre côté, la propriété de la mer qui est une particularité juridique du droit des iles devrait permettre, la où la pollution du continent peut être facilement évitée, une exploitation plus sytématique des ressources de la mer. Écloseries et fermes d'élevage seront utiles pour réempoissonner, réempoulper, réencoquillager des espaces dont les pêcheurs disent qu'ils se sont appauvris ces dernières années. La chute vertigineuse des stocks mondiaux de poissons ne concerne pas que les océans. La Méditerranée n'est pas moins menacée. Des programmes centrés sur les poissons locaux devraient se révéler d'ici à vingt ans tout à fait stratégiques... Il ne faut pas tarder à lancer les recherches et les applications.
Dans l'immédiat, il faudrait demander aux Kerkenniens ce qui leur paraît l'essence même de leurs iles, ce qui motive leur attachement à ces lieux par ailleurs chargés d'histoire et de légendes...C'est à eux de réfléchir à ce qu'est l'habitat traditionnel, à la façon de le faire évoluer sans ruptures pour tenir compte des contraintes nouvelles du 21e siècle.
Que le « rapprochement » programmé ou simplement espéré par la construction de deux voies de 6 km de long depuis la terre et depuis les iles soit effectué ou non, les problèmes évoqués plus haut demeureront. Le rapprochement aura même pour effet d'accélérer certains départs et de favoriser un envahissement touristique et constructiviste encore plus acharné, une spéculation qui voudra considérer toute terre comme terre à bâtir.
Les iliens n'ont donc plus beaucoup de temps pour décider et agir. Qu'ils n'attendent pas de l'extérieur le salut. Celui-ci leur serait confisqué par les promoteurs au profit exclusif de ces derniers...C'est de leur volonté et de leurs mains seules que dépend un avenir des iles qui ne soit pas purement immobilier et catastrophique. Hubert JOLY , avril 2005
Automne à Korba
J'ai longtemps rêvé de me retirer quelques jours d'automne à Montmajour pour réfléchir au sens de mon action, écrire un livre, ou tout simplement faire le point à la moitié de ma vie.
Dans le silence que ne trouble plus l'irritant crissement des cigales et des touristes, des chevaux paissent dans les chaumes inondés de la rizière, quelques corbeaux tournoient. Du fond du cloitre, l'admirable façade du XVIIe siècle découpe ses arcs et ses frises sur le ciel ou sur le néant. Dans la grandeur glacée de l'abbatiale, l'homme entend battre son cœur et ses tempes comme à l'intérieur d'un gigantesque coquillage abandonné par les flots sur la colline.
Mais aujourd'hui, si j'avais à méditer, je partirais un matin d'automne vers une petite ferme de la presqu'ile du Cap Bon. Là, je demanderais l'hospitalité au frère d'un de mes amis qui vit, une grande partie de l'année, seul au milieu des terres. C'est un petit bâtiment blanc en forme de quadrilatère. Franchie la porte bleue, on découvre une petite cour qu'encadrent trois pièces étroites, voutées en berceaux. Celle de gauche abrite une mule et deux vaches, celle de droite quelques outils, des réserves de grain. La troisième, au sol recouvert de nattes, est l'unique pièce d'habitation de notre anachorète.
Lavé par la pluie, mais encore embué, le ciel pâli domine un paysage apaisé d'oliviers gris sur la terre fraichement labourée, encore toute gorgée d'eau. Elle fume doucement. A peine un bruit aux alentours : juste celui de la poulie du puits qu'anime une bête descendant le chemin creux derrière la maison. Un grand murier qui n'a pas été taillé depuis longtemps laisse tomber une à une ses feuilles dorées. Deux abreuvoirs de pierre dorment près de la porte : ces sont des sarcophages d'époque romaine. Le petit banc sur lesquels je suis assis est un fragment de colonne.
La vie s'écoule lentement, sans mots ni gestes inutiles. J'observe et je retiens les mille petits usages quotidiens qui, à l'insu de mon hôte, trahissent une culture si mal connue de nous. Tout à l'heure, après avoir pris la galette et le café, l'homme partira vers les champs, sa houe sur l'épaule. Je resterai seul tout au long du jour pendant que les ombres glisseront sur les murs.
Si je m'égare dans ma méditation, si mon crayon se dessèche, je monterai peut-être sur les toits pour regarder une campagne travaillée depuis si longtemps par les hommes qu'elle parait usée. Ou j'irai de jardin en jardin, au long des haies de figuiers de barbarie, jusqu'à la sécherie de piments. Dans les sombres pièces de la masure, des souches de vignes achèvent de se consumer et mêlent leur fumée odorante à la senteur piquante des guirlandes de piments.
Au soir, je retrouverai le paysan rentré des champs ; nous ne parlerons guère faute de connaitre nos langues, mais il n'est pas toujours nécessaire de le faire pour se comprendre et, modeste ou fastueuse, l'hospitalité arabe, si extraordinairement au-dessus de celle que nous savons pratiquer, suffit à créer une communication que le silence lui-même peut exprimer. Un petit feu nous réunira dans la cour, toujours silencieux, autour du crépitement des brindilles. La nuit tombe vite.
Aux premières lueurs du jour, quand il sortira son tapis de prière devant la campagne, si lointain et si proche de lui, je lui demanderai de me faire une place à ses côtés et, tandis qu'il inclinera son front dans la poussière, à genoux moi aussi, né à nouveau du ciel et de la terre, je crois que je ne pourrai m'empêcher de me dresser, les bras tendus vers la pureté du jour, ... et de crier ma joie.
Hubert JOLY 1979
Kélibia
A Klibia, il y a du muscat, et du sec !
On le déguste à l'ombre d'une tonnelle, face à la mer. Pas besoin de cligner de l'œil pour voir danser les petits bateux de pêche dans le port. Il fait délicieusement bon, mais le vin, la chaleur de midi, infiltrent dans les veines une douce torpeur.
Il faut du temps pour savourer, une à une, chacune de ces petites satisfactions. Il faut que la vie semble s'arrêter un instant, que l'esprit s'apaise, que le corps jouisse un moment de la brise qui vient, comme une main légère, effleurer la peau.
Ce n'est pas un lieu où souffle l'esprit. Le petit bruit de succion que font les vaguelettes en se roulant dans l'écume invite à s'affaler sur le sable blanc, à laisser la chaleur dissoudre la pensée ; quand il n'en reste rien, c'est que le corps est cuit. C'est qu'il est temps de rire, d'aller se jeter à l'eau entre amis. Une gaité légère nous possède. Quand l'eau porte le corps, le sel porte l'esprit. Tout en faisant la planche, au risque d'absorber une amère gorgée, l'envie de bénir la mer, le ciel, les amis saisit le bavard. Il faut qu'il le leur crie. Il ne peut s'empêcher de faire de la philosophie. Cinquante idées piquantes montent à l'esprit. Elles résonnent sur l'eau et font naitre le rire.
Sur le soir, nous montons jusqu'à la forteresse. Pendant le jour, couronnée, byzantine, elle a plaqué l'ocre de ses murailles sur le ciel bleu. Hiératique, sa pesante immobilité semblait dédaigner nos jeux. Mais avec le lent glissement du soleil, elle se fait dorée, les ombres se meuvent entre ses pierres. Les enfants qui nous guident racontent des histoires de guerre, de torture et de corsaires.
Pourtant, à l'intérieur du grand quadrilatère, le bourricot qui tond négligemment les camomilles blanches et jaunes parait mieux accordé à la paix de ce soir.
Un épervier vole au-dessus des pins. Il s'élève en planant. Tandis que les enfants supputent ce qu'ils feront de la monnaie qu'ils escomptent déjà, je demeure accoudé aux créneaux. L'oiseau déploie ses ailes. Il n'y a plus rien au-dessus de nous. J'épouse une à une les courbes qu'il décrit. Je le suis sur le ciel, sur l'immensité de la mer, image de l'ivresse et de la liberté.
A mes pieds, Klibia vient de s'allumer dans l'ombre. Le fanal du port et l'arcade des lampadaires la dessinent dans la paix. Les derniers bateaux qui rentrent font briller l'eau sous les lumières. On entend s'élever la rumeur du café maure. Le champ de fouilles creuse un carré plus noir d'où monte le passé. La nuit vient. On peut rêver.
Hubert JOLY 1979
L'été à Tunis
La vie n'est pas un sirop de rose, même si l'on peut être abusé un instant par la douceur de l'hospitalité tunisienne.
Chaque voyage apporte ainsi son flot d'impressions et de sentiments qui, mêlés, constituent la matière première d'un songe, d'une méditation, d'une réflexion, à partir desquels s'ébauchent ou se cristallisent la pensée puis l'action.
Ces trois phases apparemment bien architecturées dans leur expression, reposent sur des faits dont l'extrême ténuité pourrait faire sourire mais dont le caractère symbolique ou frappant met en marche ce que les grecs appelaient jrhn, c'est-à-dire « les tripes », à l'esprit.
Pour moi, c'est le caractère incongru, touchant ou dérisoire, de certaines situations qui sollicite mon imagination. Ainsi, le fait que les bouquets de jasmin des petits marchands de Tunis soient piqués sur le plus prosaïque des légumes, la courge...
Ou bien, je marchais le long de la plage de Soliman et je voyais que cette Méditerranée dont je voulais faire l'instrument d'une vaste politique se contentait, par dérision, de recracher à mes pieds quelques ossements de seiche, des morceaux de liège, un peu d'écume grise.
Ou bien, dans le silence de la Médina, aux heures chaudes du jour, je prenais conscience que l'harmonie des ruelles venait du bleu, du blanc, des ombres, revêtant aussi bien les habits des enfants rapides que les larges aplats des portes et des murs.
Tel est un peu l'été à Tunis, bien différent de celui qu'évoque Albert Camus, quarante ans plus tôt à Alger. Mais on n'a pas ici la prétention de fonder une nouvelle philosophie !
S'il fallait retenir une image de l'été à Tunis, ce serait celle des soirs de Ramadan, où toute la population masculine parait rassemblée sur la grande avenue et se promène par petits groupes, à petits pas, du port à la Médina et de la Médina au port. Dans cette extraordinaire douceur où le temps semble s'être ralenti, l'étranger ne peut cependant échapper à un sentiment de malaise.
Là, comme ailleurs dans toutes les villes de la Méditerranée, en cette année de crise, l'avenir parait bouché. En amont, du côté de la Médina (ou de la Canebière), le passé n'offre peut-être plus assez de substance pour fonder une vie nouvelle. En aval, du côté du port, l'économie parait encore impuissante à donner ce que tous attendent d'elle. C'est peut-être la taison pour laquelle toute une jeunesse pleine d'une faim et d'une soif inextinguibles semble hésiter entre ces deux pôles, sans parvenir à fixer son choix.
Dans toute la Méditerranée, les deux grandes religions semblent avoir perdu le pouvoir de polarisation qui fit leur force. Loin d'être morts, les dieux anciens, auxquels on sacrifie quotidiennement, Apollon qui pue l'ambre solaire, Mammon l'inodore, Baal le cruel qui sévit à Breyrouth et Jérusalem, se disputent les suffrages des peuple, recrutent et paient de nombreux adeptes. Mais si ce sont des dieux que beaucoup servent, nul ne les aime.
Par bonheur, il y a la force des hommes de bonne volonté ! Faute d'arracher au destin la réponse qu'il se refuse à donner, ils savent qu'il n'est pas de devoir plus urgent que d'aider à nourrir les bouches et à rassembler les esprits.
C'est l'heure où, dans toutes les villes de la Méditerranée, s'éclaircissent les rangs des promeneurs, où chacun, encore lourd des tâches du jour, regagne, apaisé, sa natte ou son lit, sa terrasse ou son toit.
Partout, au même instant, de Split à Tripoli, de Grenade à Damas, comme ici à Tunis, le silence des ruelles rend aux étoiles leur majesté.
Dans cette paix qu'il sait fragile et menacée, l'étranger qui passe ne peut trouver le sommeil. Tout au long du jour, il s'est efforcé de partager les peines et les joies de ceux qui lui ouvraient, sans compter, leurs maisons et leurs cœurs, et qui maintenant reposent. Le rythme des respirations qu'il devine au-delà des murailles des médinas ou des cités antiques l'envoute et l'oppresse malgré lui. Il voudrait partager les rêves de ses frères, mais une force plus puissante martèle son esprit et le maintient éveillé. Dans son impatience de voir surgir un monde nouveau qui soit autre chose qu'un simple lendemain, il voudrait abréger la nuit, arracher les hommes au sommeil, leur crier que le soleil peut se lever pour tous et tenter, avec eux, de forcer les portes de l'aurore.
Hubert JOLY 1980
Djerba
Tout paysage est irréel tant qu'il n'est pas assimilé par l'œil et l'esprit, ou plutôt, le décor ne saurait devenir paysage sans la complicité de l'observateur. Mais la nature fait parfois le premier pas pour créer le sentiment propice à la réception des impressions. Témoin, ce matin de décembre sur la jetée du bac à Djerba.
Toute la nuit, le vent de sable a soufflé. A l'aube, il a voilé le ciel au point que son brouillard fait croire à des nuages. Mais en arrivant sur la digue, je constate qu'il s'est dissipé au point de diffuser une lumière faite de lait, de gris et d'argent. Un souffle d'air fait courir sur l'eau des frissons qu'animent les mouettes. Peu à peu, la percée du soleil fait virer les tons dans les verts et les bleus. Elle découvre les carènes de trois voiliers dont l'air nostalgique et penché témoigne de leur ultime incapacité à choisir entre ciel et mer.
Lentement, la jetée s'est peuplée, mêlant les camionnettes aux charrettes attelées de mules. Sur l'une d'elles est juchée toute une famille gagnant la terre ferme pour cueillir ses olives. Des provisions d'huile et de pain, émergent les têtes frisées des enfants et, des voiles blancs, les vives couleurs des vêtements de femmes. Dans une barque vert passé, des pêcheurs sanglés dans des cirés d'orange et d'écarlate nettoient leurs filets. L'arrivée du bac brisant l'immobilité du tableau, réveille aussi les moteurs endormis. Elle juxtapose sans parvenir à les souder, les fragments désaccordés de deux visions du monde.
Entre les deux, la lutte est inégale. Les camionnettes ont doublé la charrette et pris sa place. Le vieux qui la conduit en sera quitte pour attendre le prochain voyage. Le bac s'éloigne en crachant sa fumée. Il passe au long d'un grand bateau qui semble abandonné depuis peu de temps. Figées aux pommeaux de ses mâts, deux mouettes rigides de mépris, dédaignent d'abaisser vers nous leur bec et leur regard. Les pylones de la ligne électrique défilent à leur tour, fondus au loin dans les voiles du sable et de l'incertitude.
Déjà, Djerba disparait peu à peu entre la brume et l'eau. Avec elle, s'estompe une image bleutée que la vie moderne a déjà marquée de ses rouilles et de ses ruines, car elle ne sait pas mourir en beauté. L'enfant qui vend ses oeufs sur le bac est entrainé par le courant. Il ne peut retourner en arrière et, si le choix lui en était donné, sans doute le refuserait-il.
Et moi, je m'interroge sur ce qu'il a gagné à passer du monde ancien au nouveau. Dans un paysage qui se déchire, s'évanouit comme un rêve et laisse entrevoir plus de problèmes qu'il n'apporte d'espoirs, si je comprends qu'on ne peut sauver que ceux qu'on aime, je me demande s'il est encore possible de le faire.
Hubert JOLY 1979
Sidi Bou Saïd
Au mois de janvier, Sidi Bou Saïd est déserté par le touriste. Ses terrasses ensoleillées n'attirent plus que quelques promeneurs tunisois, des mères de famille, des amoureux. Sous le vent léger, se déploie le panorama tranquille de la baie. Les troupeaux de poissons tout bleus qui s'y cachent paissent sous son eau calme. Car ici, tout est bleu ou tout est blanc. Ou presque : car le bleu du ciel rend plus vert le feuillage dentelé du mimosa, comme le blanc des murs verdit celui de l'oléastre. Il faut choisir : ou boire un thé brulant dans le blanc des banquettes inondées de soleil ou siroter une menthe verte et glacée dans l'ombre bleutée de la coupole. Et perdre son regard au-delà de la mer, vers les monts qui dominent Korbous. S'imbiber de la paix.
Puis bondir sur ses pieds, courir jusqu'au bout du chemin dallé, apercevoir un sentier de chèvres qui descend jusqu'au port, et puis le dévaler. A mi-pente, nous découvrons dans la végétation la tache claire du corsage et de la chemise d'un couple. Le premier, je les vois. De loin, je crie :"Ohé, les amoureux, attention, nous voilà !". Et je passe en courant. Ils rient :"Merci de nous avoir prévenus". Dix mètres plus bas, je m'arrête et je me retourne : "Bonjour, je suis charmé de vous connaitre et désolé de vous perdre si vite car nous ne nous reverrons peut-être jamais. "Qui sait ," répond le garçon. Oui, qui sait ?
Nous repartons dans notre course folle ; un instant pour s'arrêter : un déclic, une photo. D'un bond, nous franchissons le talus, d'un autre, la route.
Dans l'eau tranquille, de grosses barques de pêche, mais aussi quelques bateaux plus riches, plus corrompus, plus triomphants de cuivre et de plastique. Presque invisible derrière son pare-brise de verre teinté, un homme regarde à la jumelle. Vers le large ? Non. Là-haut vers les amoureux. Il doit être déçu car les voilà debout qui nous font de grands signes.
Nous escaladons les rochers de la digue.
D'un côté, c'est le silence, l'eau claire et calme, la chaleur du soleil du soir sur les joues. De l'autre, le vent, les vaguelettes aux crêtes blanches, le ressac contre les blocs énormes.
Nous marchons vite sur la route qui monte dur ; pauvre Amilcar, si tu avais su que tu terminerais comme chef de gare d'une station du petit train de la reine Didon, tu te serais fait une autre idée de l'Histoire ! Et moi, je ne serais pas ce soir, comme le chef borgne dans le wagon gétule, à regarder luire l'œil sanglant du soleil sur les flamants de la lagune.
La faim nous prend par les talons avec la nuit. Nous rentrons vite à la maison. "Ô grand Mokhtar, ton couscous est royal, ta chorba digne d'Annibal, ton citron...de Scipion". Le pain trempé dans la sauce est moelleux. On aimerait avoir une barbe pour l'y faire couler, l'étaler, la sucer.
Dans mon demi-sommeil, je révise encore ma leçon d'arabe : dans un ultime effort de synthèse du rapport d'annexion, des diptotes et du duel, une question revient sans cesse, lancinante et sans réponse : "Comment sont les joues d'Amina ? De rose ou d'abricot ? Je veux savoir. Amis répondez moi !"
Hubert JOLY 1982
Ramadan
On fera cent fois le tour de Tunis sans encore la connaitre si l'on ne l'a pas vue un soir de Ramadan.
Encore faut-il accepter une sorte de jeûne intellectuel, faire le vide en soi pour être disponible. Car le dialogue entre la ville et le promeneur est à l'image de celui qu'entretient l'eau avec l'éponge qui s'est d'abord laissé presser...
Dès que le soir est tombé, la vie se retire soudainement de la Médina ; le passant attardé n'a plus pour le guider de loin en loin que les lumières des échoppes où des enfants, gardant le magasin, mangent silencieusement le repas du soir. Le souk des cordonniers, marqué par son odeur de cuir, parait bien déplacé avec tant de souliers pour tant de pieds qui se sont enfuis sans bruit.
Dans celui des chaudronniers, brillent encore quelques éclats mystérieux et barbares des cuivres jaunes ou rouges. Seuls les échos d'une obsédante radio, renforcée au passage de chacun des magasins encore ouverts, rythment la promenade solitaire.
Mais la nuit s'avance. Elle fait peu à peu renaitre la vie. Les rideaux de fer se soulèvent. les ballots de fripes multicolores de la Hafsia prennent sous la vive clarté des lampes la forme de chimères nées d'un accouplement monstrueux de la misère et de la nuit.
Tandis que les pâtissiers s'affairent autour de leurs gigantesques bassines de friture, comme un amas de mouches attirées par leur odeur d'huile et de miel, la foule vient peu à peu s'engluer le long des éventaires. Au centre de ce tourbillon de chaleur et de visages qui se pressent, de pieds qui s'écrasent, la grand-place de la Zitouna fait penser à l'œil du cyclone : le bruit s'est arrêté au pied des grands portiques. Un café maure s'est improvisé tout au long. Pas de musique; rien que des petits groupes en train de bavarder autour de trois rangées de tables. Quelques connaisseurs se repassent, en hochant du chef, le tuyau d'un narghilé. Sur une façade sans ombre, se découpe dans l'ocre la blancheur d'une arcade géminée fermée de volets sombres, où s'inscrivent encore deux réductions d'un motif ornemental semblable.
Tout est bon, calme et doux.
Dans cet espace de paix qui n'a pas d'âge, on oserait peut-être souhaiter que le temps s'arrête, que cesse une course dont on doute qu'elle ait un sens.
Mais le torse bronzé d'un adolescent à peine couvert, virevoltant au milieu des tables, relance l'interrogation. Que sera pour lui la vie après l'Aïd? S'il rit ce soir de ses haillons, si ses yeux brillent, s'il tête goulument la pipe qu'il arrache à la main d'un camarade, que demandera-t-il au monde de demain?
Hubert JOLY 1983
Mourir pour Testour
Enseveli sous les quolibets et les sarcasmes qu'échangeaient par dessus ma tête Moncef et Lotfi, j'ai failli mourir pour Testour. Il est vrai que le premier, surpris en pleine nuit par un coup de téléphone du second pour préparer notre expédition, avait encore les yeux bouffis de sommeil : ses quinquets ne purent être ramenés à leur taille normale qu'à la faveur d'un café longuement négocié.
J'ai failli mourir pour Testour mais cela en valait la peine, car ce n'est pas tous les jours qu'un maire entreprenant tente de montrer à des fonctionnaires retranchés derrière les papiers et les règlements qu'il vaut mieux forcer les procédures pour lancer rapidement une opération de construction conforme à l'esprit de la loi, plutôt que d'en respecter les formes et, perdant des mois en commission, assister impuissant à l'anarchie des constructions sauvages...
Surtout, j'ai retrouvé à la tombée du soir les racines andalouses de la cité dominant un coude de la Medjerda au milieu des jardins.
Alors que les ministères s'interrogent gravement sur l'utilisation des matériaux locaux, la mosquée apporte dans la lumière adoucie de la tombée du jour une réponse de quatre siècles, faite de tuiles grises, de murs crème, de corniches et de lits de briques roses. Ce n'est pas le plus somptueux qui est le plus beau mais l'équilibre des surfaces doucement colorées, la grammaire des assemblages, les escaliers à noyau hélicoïdal qu'on sent moulé à la main, le damier des briques sur les parois des minarets, l'harmonie d'un monde menacé par l'âpreté d'un conflit entre les avenirs et le présent.
Oubliant un instant la tension qui sourd par moment dans le pays, descendons jusqu'à l'atelier du dernier briquetier. Sous la double rangée d'arcades, sous le toit aux voutins de plâtre encore marqués de la trame des sacs qui les ont moulés, deux bourricots échappés de Peau d'âne, fournissent le crottin d'or qui, mêlé à l'argile , rendra les briques sonnantes et légères. C'est sur le gabarit de la cuisse de ce Jupiter cuiseur que sont formées les tuiles, pour que l'homme demeure la mesure de son propre univers. Cependant, l'énergie pour cuire les carreaux coute de plus en plus cher, la toiture en terrasse l'emporte peu à peu sur les pans de tuile andalous, les jeunes ne se soucient pas de malaxer la boue et le vieux n'a pas d'apprenti à qui transmettre les tours de main venus de Cordoue, de Séville ou de Grenade. Heureusement que l'embrasure de la porte d'entrée sur la terrasse trace un cadre lumineux de rivière, de vergers, de montagne et de ciel.
Familier du dialogue que le payage renoue chaque jour avec le soleil du soir, je me prête sans défense au charme de sa douceur. Ce ne sont pas les inconnues de la politique ou les taux de ciment dans les dosages de terre stabilisée qui peuvent me la faire oublier.
Des fèves, une bière - oui, j'ai bien dit une bière -, des brochettes et quatre joyeux lurons, un grand pont par dessus le fleuve, fallait-il en demander davantage à l'instant qui vient de passer ? J'avoue que je ne l'ai pas fait.
1985
Tunis 2010. Il y a donc trente-trois ans que je suis venu à Tunis pour la première fois, c’est-à-dire le temps qu’il a fallu à Jésus et à Alexandre pour naitre, vivre et finir fusillés, l’un par des clous, l’autre par le paludisme. Et voilà que j’ai plus du double de leur âge et que je n’ai fondé ni nouvel empire, ni nouvelle religion. Dieu ! Que c’est donc frustrant.
Heureusement, quand je suis arrivé, il y avait du soleil, tandis qu’il gelait à pierre fendre en France. Ce temps doux mais sec, au grand dam des agriculteurs, a encore duré quatre jours et l’orage tant désiré est enfin arrivé. Vent qui agite furieusement les petits drapeaux multicolores de la rue Charles de Gaulle, volets mal ajustés qui claquent, un peu de grêle qui disperse les passants encapuchonnés, une série de coups de foudre secs et précipités, curieusement sans écho ni roulement, et c’est déjà fini. Une misère, à peine sept millimètres d’eau. Ce n’est pas ce qui va donner à boire à une moisson dont la moitié est déjà perdue.
Un matin, je suis allé dans le souk El Belat, rue du Trésor, pas moins, chez le microcoiffeur à qui je laisse en otages quelques cheveux blancs tous les six mois ou tous les ans. Dans la petite échoppe qui a été totalement rénovée vers…1914, se désordonne tout un bric-à-brac de peignes, flacons, serviettes et ciseaux, sous une frise de stuc à vasques et rinceaux rehaussée par endroits de bleu délavé au céladon, le tout sous un plafond de bois sombre en dodécagone allongé à trois niveaux, dont l’un porte des fleurons. Je gage que le coiffeur, ses aides et ses clients n’ont jamais levé la tête pour l’admirer.
Qu’importe ! Car il y a la télévision. On y voit d’abord un chanteur sucré psalmodier sur au moins trois notes une mélopée d’un long quart d’heure qui doit être tragique. Puis, du fond d’un improbable Yémen, surgissent quatre malabars moustachus à kefiehs et gandouras blanches qui dansent comme des demoiselles de pensionnat mais en agitant sombrement d’énormes couteaux de boucher. En toile de fond, virevolte (enfin… voudrait virevolter…) une dame respectable dont les avantages postérieurs font penser aux coupoles de Sainte Sophie et de la Soumleimaniè. Quant aux superstructures antérieures, à les voir ballotter mollement, on croirait entendre un bruit de lait caillé.
Une copieuse rasade de Coran plus tard, c’est un groupe de derviches femelles qui se démène à faire tournoyer de longues chevelures noires déployées, dont on connaît chez les Arabes, l’irrésistible puissance érotique. A ce train là, on se dit que les mollahs ont encore du cheveu à retordre… Ainsi va la vie !
En redescendant, je me fraie à grand peine un chemin sur les cartons mouillés de la rue de la Commission, au beau milieu d’un souk chinois qui doit bien surprendre le fantôme de Garibaldi, ancien habitant temporaire du lieu.
Je pourrais maintenant marcher les yeux fermés, guidé par les odeurs fraiches des fruits et légumes, puis celles des poissons, et même celles, nettement moins appétissantes, des volailles entassées dans les cages. Mais il faut de tout pour faire un monde, n’est-ce pas ? Pire ou meilleur que le nôtre ? Cela dépend des instants. Faudrait voir…
Janvier 2010
Je suis venu m’assoir au café du port de Kelibia. Trente ans après. Quelle horreur ! On a cent fois raison de condamner la nostalgie, sentiment littéraire éculé, mais qui peut s’en défendre s’il a la chance de vivre assez longtemps ?
Il y a trente ans, c’était encore Bourguiba, qui n’était pas un enfant de chœur contrairement à la légende dorée, et dont les discours-fleuves ressassés faisaient les beaux soirs de la télévision. Ce n’était pas encore Ben Ali qui n’était, je crois, que colonel, mais mon vieux maitre Salah Hamrouni en avait déjà peur… Et voici qu’après deux règnes, un troisième cycle s’ouvre, aussi riche de promesses que d’incertitudes. Le papillon tunisien peine à se dégager de sa chrysalide : le vieux monde résiste et nul ne sait, malgré l’espoir, comment vont tourner les choses.
À part quelque barbelés sur l’avenue Bourguiba et de petits paquets de policiers en uniforme noir, tout parait anodin. Mais une certaine confusion règne dans les rues comme dans les esprits : maints responsables d’administration ont été priés de déguerpir, mi-vox populi, mi-règlements de compte. Les vendeurs à la sauvette se sont abattus sur les trottoirs comme sauterelles en champs de blé. Des constructions sauvages jaillissent en une nuit. Les voitures se garent sur les trottoirs sans crainte de contravention. Les cafés ont refait leur plein de désoccupés. Pas un touriste à l’horizon et nombre de boutiques sont encore fermées. Les barrages ont disparu des routes et les Tunisiens respirent une bouffée de libération, pas encore de liberté. Car la majorité de la population essaie de sentir d’où va souffler le vent et il y a encore peu de courageux pour en faire.
Une grande quantité de petits partis (23 ?) est en voie de création, mais un tel émiettement pouvait favoriser les tenants de l’ancien système qui ont des cadres, de l’argent et qui pourraient vouloir créer une sorte de parti de l’ordre si la semi-vacance du pouvoir dure trop longtemps avant des élections qu’on ne voit guère avant quatre mois au mieux.
Comme toujours, il y a de l’inattendu et, cette fois, c’est du côté de la linguistique… Un verbe français, à l’impératif, vient de gagner ses galons internationaux : « Dégage ! ». Dégage Ben Ali, dégage Moubarak, dégage Bouteflika, dégage Assad et bien d’autres trop nombreux pour que je puisse tous les nommer. Le rigolo de l’histoire est que ce « Dégage ! » aurait en arabe une très joie racine trilitère qui est celle de « poulet », aux deux sens du mot. « Dégage, poulet, c’est ton tour d’être plumé par ceux que tu as plumés ! » Et voilà comment un mot français devient un néologisme arabe.
Il y en a une, qui a été toute surprise d‘entendre crier « Dégage Moubarak ». Reléguée dans un hangar à Port-Fouad depuis 1956, la statue de Ferdinand de Lesseps n’avait pas entendu « causer » français depuis bien longtemps. Elle espère reprendre sa place sur son socle qui existe toujours. Car c’est tout de même à elle que l’Égypte doit une bonne partie de ses ressources aujourd’hui. Et puisqu’on en est à demander un peu de justice là-bas, pourquoi pas pour elle aussi ?
Sans casser des œufs ! La révolution tunisienne a cassé des œufs. Heureusement pas trop. Mais tout l’art du cuisinier est maintenant d’éviter de bruler le plat…
On connait les années de désordres, de la Terreur au Directoire, qu’a coutées au peuple français sa Révolution, jusqu’à ce qu’un général, nommé Bonaparte, s’empare du pouvoir pour créer, non une démocratie, mais un empire autoritaire qui a conduit à Waterloo. On voudrait éviter ce parcours à nos amis tunisiens.
Ce qui manque aujourd’hui au gouvernement de transition, ou de circonstances, c’est la légitimité, sans laquelle aucune mesure forte ne peut être acceptée par les citoyens. Il faut donc des élections aussitôt que possible, pas trop tôt pour permettre aux nouveaux partis de s’organiser, pas trop tard pour éviter que ne se prolonge l’incertitude et l’instabilité. Il faut aussi éviter, on l’a dit, l’émiettement des partis qui rendrait la République ingouvernable comme l’a été feu la Quatrième république en France. Il faut donc que les nouveaux partis acceptent de se regrouper au sein de « contrats de législature » par lesquels ils s’engagent sur des programmes communs minimaux pour cinq ans.
La priorité est, bien entendu, la restauration des libertés publiques, parmi lesquelles la liberté religieuse et il faudra bien faire place aux plus radicaux des musulmans pourvu qu’ils respectent ceux qui ne veulent pas appliquer leur doctrine.
Ensuite, il faut faire redémarrer l’économie. On sait bien que les révolutions ne créent pas d’emplois, sauf chez les marchands de bière. Or la Tunisie a un cruel besoin de mettre au travail non seulement sa jeunesse diplômée au chômage, mais aussi tous les laissés pour compte de l’ancien système sans aucune formation et qui ne survivent que dans une pauvre sous-économie de la débrouille.
Tant que la stabilité ne sera pas assurée, on ne verra pas les investisseurs étrangers se bousculer à la porte de la Tunisie. Il faudra aussi beaucoup d’efforts et d’exemples venant du sommet de l’État pour que l’ancien système d’extorsion et de corruption soit démantelé, tant il était ancré dans les mauvaises habitudes.
Et maintenant, comment créer de l’emploi ? Voilà bien de quoi empêcher de dormir les nouveaux responsables !
Le tourisme a subi un rude coup pendant plus d’un mois, quelques usines et quelques grands magasins ont été brulés, des grèves se sont produites. Il faut savoir qu’un serveur de restaurant de la capitale, âgé de 25 ans, éventuellement chargé de famille, gagne 5 euros pour dix heures de travail quotidien, que son jour hebdomadaire de repos ne lui est pas payé, qu’il n’a ni contrat, ni protection juridique, ni protection sociale.
Comment s’étonner dès lors que les travailleurs attendent des effets immédiats et miraculeux de la Révolution ? Ils ne viendront pas, mais il faudra bien apaiser leur impatience par des augmentations de salaires. Mais, indispensables politiquement, il se peut que ces dernières soient peu à peu dévorées par l’accroissement des prix des subsistances qu’elles engendreront. Alors, leur effet bénéfique serait dissipé rapidement et la déception gagnerait ceux qui ont espéré dans la Révolution.
Il y donc trois priorités : investir, investir, investir. Pour renforcer la compétitivité de la Tunisie par rapport au Maroc, à la Turquie, aux pays d’Asie. Remonter le niveau des hôtels touristiques dont beaucoup sont très défaillants, refonder les transports collectifs, aider l’agriculture à évoluer, traiter les énormes problèmes de l’eau, des déchets, de l’accès aux soins et de l’environnement. Que va devenir l’État si Khadhafi cesse de payer les fonctionnaires[1] ???
Aussi, en dernier ressort, un accroissement temporaire du déficit de l’État au profit du seul investissement productif et social parait indispensable, de même qu’un renchérissement du prix des produits importés par des mesures douanières ou monétaires appropriées…
À parler franc, comme on le doit à des amis, tout cela ne serait pas indispensable si tout ce que le pays a perdu et perd encore dans la corruption pouvait être récupéré et investi dans la productivité de l’économie. En attendant que les investisseurs étrangers reviennent, c’est la Tunisie, toute seule, qui se sauvera ou se perdra. Il faut que chaque Tunisien, chaque Tunisienne en soit persuadé et que chacune et chacun fasse respecter cette foi et cet espoir dans tous les actes et les gestes de la vie quotidienne. Amis tunisiens, le voudrez-vous de toutes vos forces ? Le ferez-vous ?
La vitesse de l’Histoire dans le monde arabe, aujourd’hui, est telle que le début de la phrase que j’écris est déjà périmé lorsque j’arrive à sa fin… On court le risque d’être totalement dépassé et de paraitre ridicule dans vingt ans si l’on relit des textes qui n’auront pas su prendre la mesure des bouleversements actuels. Et pourtant, il faut bien essayer d’analyser, de comprendre et de continuer à comprendre au fil des jours afin de prévoir et de bâtir les grandes lignes d’une politique pour demain.
Sous ces réserves, je tente donc de décrire ce que je vois ou que je crois voir.
Le séisme du soulèvement tunisien a donc provoqué un raz-de-marée qui touche indistinctement les pays pauvres et les pays riches du monde arabe : les peuples n’en peuvent plus !
Quelques constatations :
1) Il est amusant de remarquer que les peuples arabes se sont emparé pour leur usage propre du fameux slogan du pape Jean-Paul II « N’ayez pas peur ! » pourtant conçu à l’usage des chrétiens du monde communiste est-européen. C’est pourquoi la chute du régime libyen est inscrite dans les faits, la seule variable étant le nombre des morts qu’elle coutera. La même observation vaut pour le Yémen et sans doute aussi pour les plus durs et les plus coriaces que sont l’Algérie ou même l’Iran d’Ahmadinejad.
2) Ceux qui n’ont pas entamé les réformes vers plus de justice ont intérêt à se hâter pour rattraper le retard, sinon ils vont disparaitre comme les autres.
3) Tout le monde a souligné le rôle d’Internet et des réseaux sociaux, mais, si la puissance émotionnelle de l’image et du son instantanés ont pu créer des mouvements de foule, seuls les médias traditionnels, avec leur capacité d’analyse critique enfin libérée, ont aujourd’hui le moyen de comprendre et d’orienter les mouvements de fond des sociétés avant que les partis politiques nouveaux ne soient en mesure de les catalyser. Autrement dit, si Internet et face-book ont été les détonateurs, l’explosif est encore enfoui dans les sociétés.
4) On a agité le chiffon rouge de l’islamisme aux yeux des Occidentaux et certains de ceux-ci, comme les Américains, ne se sont pas privés de l’exploiter à fond pour leurs ingérences, mais, en Tunisie, comme en Égypte, on a bien vu que les mouvements islamique et islamiste ont été dépassés par les évènements populaires et relégués à l’arrière-plan. Chaque répression a beaucoup plus tué que tout Al Qaïda n’a jamais fait de morts. Face au mouvement légitime de révolte qui est en train de se produire, Al Qaïda n’est qu’une grenade, certes dangereuse, mais surtout parce qu’elle est le fait de manipulateurs à multiples détentes des services secrets variés.
En fait, il est probable que ce à quoi nous assistons va conduire à une certaine sécularisation de la société arabe, en même temps que se produira une remise en question et un aggiornamento de l’islam par les musulmans eux-mêmes.
5) Venons-en aux Européens. Aveuglés par leurs combinaisons avec les mafieux des dictatures ou bien se servant de leur nombril comme d’une lorgnette, il n’est pas étonnant qu’ils n’aient rien vu avec un tel instrument d’optique. Les voilà pris au dépourvu et uniquement focalisés sur le problème des immigrés clandestins.
Depuis trente ans, je répète à qui veut l’entendre que si les portes du Maghreb et de la France s’ouvraient en même temps, je traverserais la Méditerranée à pied sec sur le dos des nageurs. Eh bien, nous y voilà, que les portes soient ouvertes ou fermées !
Pendant des années, je me suis échiné à publier une revue intitulée Perspectives méditerranéennes et je n’ai jamais eu un soupçon d’aide ou d’intérêt de la part des pouvoirs publics. J’ai seriné en vain que le monde arabe occupait une position stratégique dans la gorge de la francophonie et qu’il était vital de coopérer avec ses peuples faute de pouvoir le faire avec les dirigeants. Peine perdue. Le seul commentaire que j’aie jamais eu a été celui d’un diplomate distingué du Quai d’Orsay : « Vous vous dispersez trop ».
6) Alors que faire ? vais-je répéter.
Nous tromper une fois de plus d’adversaires, d’alliés et d’objectifs ? Nous ne pouvons pas proposer au monde arabe qui connait une néo-Nahda sans aucune mesure avec celle qui avait suivi l’expédition de Bonaparte, une coopération de bouts de ficelle qui n’aurait pour objectif que de réguler les flux migratoires. Comme le fait observer si justement un article du Monde daté du 24 février, une nouvelle politique européenne à l’endroit du monde arabe serait de nul effet et même contreproductive si elle ne comporte pas une dimension transcendantale, alliant générosité, fraternité et vues à long terme.
7) Et nous simples citoyens dans tout cela ?
Cette nouvelle coopération est très difficile à mettre en œuvre concrètement à notre échelle bien entendu. Mais il dépend au moins de nous, non pas de donner des conseils ou des leçons qui seraient très mal perçus par nos amis arabes, mais de les soutenir fidèlement et de les accompagner sur le dur chemin qu’ils ont à parcourir, maintenant qu’ils ont retrouvé leur fierté et leur dignité de peuples libérés par eux-mêmes.
Tunis 23 février 2011[1]. Hubert Joly fait allusion au fait que Khadhafi, qui a soutenu jusqu’au bout le président tunisien, en faisant les fins de mois de Ben Ali, lui donnait l’argent pour payer les fonctionnaires tunisiens... (N.D.L.R.)
Vu de Paris et par le trou de la serrure, il est difficile de juger avec justesse de ce qu’on appelle déjà la « Révolution du jasmin », si les évènements confirment les premiers développements.
Toutefois, quelques réflexions émergent de l’abondance des informations et des commentaires parfois contradictoires.
Tout d’abord, et même si le hasard a été téléguidé, ce qui est frappant est la soudaineté de l’effondrement d’un régime que l’on disait le plus fort des régimes autoritaires du basin méditerranéen. C’est l’image même du colosse aux pieds d’argile que le prophète Daniel emploie pour désigner l’empire babylonien de Nabuchodonosor. Qui aurait jamais pensé que l’immolation par le feu d’un garçon de Sidi Bouzid suffirait à ruiner l’édifice policier construit pendant 23 années. L’événement est aussi surprenant d’un côté que de l’autre. Voici qu’un garçon inconnu, sans ressource autre que son désespoir, rentre avec fracas dans l’Histoire et fait trembler tous les dictateurs du monde arabe. Et voici qu’un système verrouillé par l’armée, la police et le parti unique se liquéfie en moins de trente jours…
Quel sujet de méditation pour les philosophes et les politologues !
Le second sujet d’étonnement est la cécité des Européens, voire des Français, dans cette affaire. Ou leur aveuglement volontaire… Ou leur lâcheté. Car tout le monde connaissait le régime tunisien et ses pratiques. Mais il est vrai qu’il était plus facile de s’en accommoder, voire de faire des affaires avec lui, que de le combattre…
Le fait est qu’en général, les chancelleries préfèrent avoir affaire à un pourri qu’elles connaissent et que, de ce fait, elles peuvent limiter ou manipuler, que de se trouver avec un nouveau dont on ignore les projets et qui, chose terrible, pourrait être honnête et sincère.
La troisième surprise pour l’opinion publique mondiale, et non pour les spécialistes qui étaient au courant, est l’absence totale des islamistes dans les évènements des jours derniers. Alors que l’épouvantail des radicaux a été agité constamment depuis vingt ans, alors que les journalistes interrogeaient encore hier la population en demandant : « Ne croyez-vous pas que Ben Ali était un rempart contre l’islamisme ? », on voit bien que la Tunisie, dans sa généralité, n’a nullement sombré dans l’intégrisme, que la plupart des musulmans sont semblables à la plupart des chrétiens, pieux, traditionalistes, modernistes, tièdes ou indifférents selon les cas…
Alors maintenant ?
Ce qui vient de se passer est tellement nouveau pour un pays qui a été mené pendant vingt-trois ans avec une main de fer que la transition ne pourra pas se faire sans un certain nombre de secousses. Beaucoup de Tunisiens ont été, malgré eux, plus ou moins forcés de collaborer avec le régime et il demeure dans le pays des nostalgiques de l’ancien système. Il faudra donc que la nouvelle équipe réussisse, sans drames, à assainir la situation politique et l’administration puis à les remettre au travail dans une confiance totalement rénovée.
Les nouveaux dirigeants tunisiens devront composer avec des exigences contradictoires : la première est la nécessité d’une purge aux niveaux les plus élevés de l’Etat sans cependant le décapiter, car il faut bien continuer à fonctionner, la seconde est d’éviter une chasse aux sorcières qui empoisonnerait durant de longs mois le pays et l’empêcherait de redémarrer : il est probable qu’il faudra en finir par une amnistie assez large pour tous ceux qui se sont compromis sans aller jusqu’au crime, afin de rétablir une sécurité morale et économique.
Bien entendu, l’idée d’une vaste amnistie ne peut que choquer tous ceux qui voudraient voir la justice sanctionner les coupables mais le réalisme oblige à faire preuve de plus de discernement…
J’ai toujours été un peu choqué par le célèbre aphorisme de Pascal « Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force, afin que le juste et le fort fussent ensemble, et que la paix fût, qui est le souverain bien ».
Et pourtant, il faudra bien se résigner à un peu moins de justice pour un peu plus de mansuétude à l’endroit de ceux qui ont failli parce qu’ils n’ont pas eu le courage de résister aux sollicitations et pressions du régime, car la Tunisie de demain va avoir besoin d’une réconciliation nationale, d’une confiance retrouvée et d’une stabilité indispensable…
Bien sur, cela ne sera pas facile.
Mais, dès que les élections auront permis de décanter la situation actuelle, la France et les autres Européens doivent appuyer au maximum la Tunisie, en lui apportant l’aide financière dont elle aura besoin pour faire redémarrer sur des bases saines ses entreprises et donner du travail à la jeunesse qui est restée à l’écart de l’économie. Sans cela l’espoir qui s’est éveillé ne se maintiendra pas et la situation redeviendra ce qu’elle était.